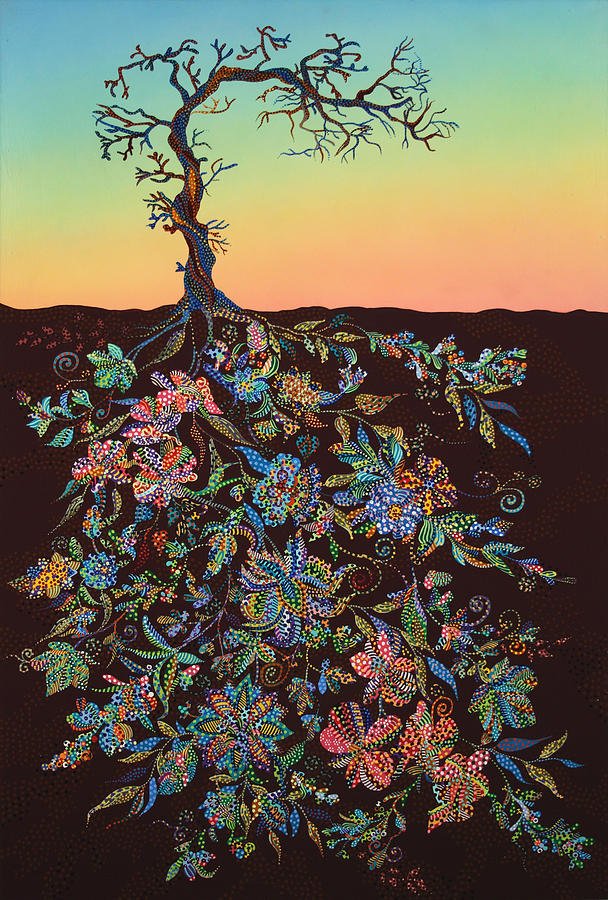Quand ton chez-toi te rend malade [TEXTE COUP DE COEUR]
![Quand ton chez-toi te rend malade [TEXTE COUP DE COEUR]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5c9ac5010b77bd2241565fec/1638671907030-R2QEELWWO5PPQSTURAN4/Winter+Night_Maurice+Cullen.jpeg)
par Clara Coderre
Dernier coup de moppe sur le plancher taché de la cuisine trop éclairée. Dernier essorage propulsé à l’huile de coude pour retirer le surplus de liquide grisâtre. Dernier coup d’éponge sur le comptoir en inox, rempli, moins de quinze minutes plus tôt, de légumes légèrement ramollis et de mayonnaise bien grasse. Petit coup d’œil à l’horloge dont l’aiguille s’approche rapidement du onze heures libérateur. Soit. Deux ados, visiblement à leur première ou deuxième date, rigolent encore dans la salle à manger. Ils dégustent leur sandwich, trop épris l'un de l'autre pour se soucier de tout le reste, incluant le gentil monsieur qui les a accueillis à onze heures moins quart et qui n’a pas rechigné en ressortant les pots de cornichons déjà rangés pour le lendemain. Quand le garçon se penche au-dessus de la table pour déposer un baiser tout doux sur la joue de sa nouvelle amie, elle rougit et ne dit mot, comme pour ne pas briser le silence qui enferme jalousement leurs sentiments.
L’homme éteint les lumières superflues de la cuisine qui commençaient à lui donner mal à la tête et à l’esprit. Il revient vers la salle à manger et repasse mollement sa moppe sur le plancher pourtant déjà net, ne voulant pas interrompre insensiblement la romance naissante, mais ayant tout de même l’envie irrépressible d’étendre son corps rendu trop vieux pour rester debout toute la journée.
Il ne peut retenir un petit sourire devant la scène qui se déroule sous ses yeux lui, se rappelant ses propres sorties, ses propres premiers émois, quand ses cheveux légèrement bouclés, tombant sur son visage délicat, attiraient des filles magnifiques sans qu’il n’ait à ouvrir la bouche.
Peu pressés ni par le temps ni par la vie, les deux tourtereaux ne peuvent ignorer leur serveur lorsqu’il lave la table voisine pourtant reluisante. Polis, ils lui font signe qu’ils terminent leur goûter de fin de soirée et sont sur leur départ. Onze heures et douze. Bras-dessus-bras-dessous, ils traversent la porte dans un son de grelot et saluent l’employé qui leur envoie la main en retour. Il passe son linge sur la table nouvellement dégagée, s’assure qu’il n’a rien oublié, verrouille les serrures, puis va chercher ses effets personnels à l’arrière, avec le sentiment du devoir accompli et le cœur léger malgré la lourdeur de ses membres.
Il sent l’air de la nuit embrasser son visage dès qu’il traverse le seuil de la porte vers la ruelle. Il inspire profondément la fraîcheur qui le débarrasse d’un seul coup des effluves de viandes froides et d’oignons marinés. Cette brise vierge s’accouple toutefois d’une violente quinte de toux qu’il ne peut réprimer, comme assagi par une force dont il se ne se croyait même pas capable. Comme si ses poumons lui faisaient vengeance devant cette libération pourtant tant désirée. Sa peau devient écarlate, il s’arrête, se penche, tente de maîtriser les élans de son corps qui tout entier semble vouloir exploser. Il ferme les yeux, se ressaisit péniblement, inspire, expire, et continue tranquillement son chemin, déchiré par cette manifestation sauvage qui le surprend chaque fois.
Il traverse le parc qui le sépare de son quartier, dans une ville qui va paisiblement se coucher, malgré des lumières qui ne s’éteignent jamais. Des feuilles mortes jonchent les trottoirs bétonnés, un peu humides sous ses robustes souliers de marche. Les mains dans les poches, sa respiration se calme lentement, il arrive bientôt.
Peinture de Maurice Cullen, “Winter Night, Craig Street, Montreal, 1899”
Il enfonce la clé dans la serrure de son petit 3 ½, vidé de son âme et des affaires de sa femme, partie le premier du mois avec le besoin de larguer son mari pour prendre le large. Il entre dans le vestibule, accroche son coupe-vent au porte-manteau chambranlant, puis va nettoyer la chaudière du salon qui se remplit, une goutte à la fois, de jus de plafond les jours de pluie. Il en a glissé un mot au proprio, qui lui a répondu qu’au prix auquel payait le loyer, il n’avait qu’à décrisser si l’endroit ne lui convenait pas. Comme s’il avait cette option. Il jette un coup d’œil aux lattes du plafond, visiblement gorgées d’eau et de spores, les maudissant de lui donner tous ces spasmes. Il ne sait pas combien de temps il pourra endurer cela, mais pour l’heure, se dit qu’il vaut tout de même mieux un toit qui fuit qu’aucun toit la nuit.
Note :
Cet été, j’ai travaillé à l’Office municipal d’Habitation de Montréal (OMHM), un organisme parapublic qui aide les locataires de l’île lorsqu’ils se retrouvent à risque de perdre leur logement. Plusieurs d’entre eux m’ont raconté des histoires horribles sur la condition de leur appartement, aux prises avec des problèmes de moisissures, d’insectes ou de rongeurs. Souvent, ce manque d’entretien conduisait, sans surprise, à des ennuis de santé physique, en plus d’une détresse régulièrement exprimée. Même si cela peut paraître évident, j’ai réalisé par cette expérience l’ampleur du lien qui unit logement et santé, car un logement malade rend malades ses habitants.


![Le venin des hommes [TEXTE COUP DE COEUR]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5c9ac5010b77bd2241565fec/1638652973472-VAFVY9A8VU1KQCRBWI0D/Le+venin+des+hommes.jpg)

![La thérapie psychédélique : le miracle négligé [TEXTE COUP DE COEUR]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5c9ac5010b77bd2241565fec/1638668657968-MVXZFWVMOCAA8HUZ7DMQ/La+the%CC%81rapie+psyche%CC%81de%CC%81lique_1.png)